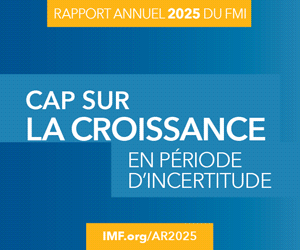C'est dans le théâtre qu'Augusta Palenfo s'est faite connaître du grand public après une formation à l'école de théâtre burkinabè entre 96-97. Cette expérience lui a permis de se produire à l'international avec les compagnies « Marbayassa » et « Les Merveilles du Burkina ». Mais avec la comédienne, il n'est pas question de se donner de limites.
Dès lors, elle se lance dans le cinéma et décroche son premier rôle en tant qu'actrice dans la série Sita de Missa Hiébié. A partir de là, elle enchaine les films les uns après les autres, remporte des prix. Mais sur les plateaux de tournage, Augusta a une idée derrière la tête : être réalisatrice. C'est ainsi qu'elle observe les moindres faits et gestes de baobabs du domaine qu'elle a la chance de côtoyer.
C'est le cas d'Idrissa Ouédraogo, Missa Hébié, Issa Traoré de Brahima. Son rêve devient une réalité en 2017 lorsqu'elle signe son premier long métrage qui a été sélectionné au FESPACO. Pour la 29e édition de ce rendez-vous du cinéma africain, Augusta est présente avec Waongo.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
A quelques jours du clap d'ouverture du FESPACO 2025, le mercredi 19 février, nous avons rencontré cette dame aux multiples casquettes à Kilô Accademi, où elle gère la communication. Avec la mère de 4 enfants, son parcours, sa vie de familles, le cinéma n'ont pas été un tabou. A propos du dernier point, pour elle, si les films burkinabè peinent à décrocher le graal au FESPACO depuis des années, cela est du à un problème financier.
Augusta Palenfo est surtout connue du grand public grâce au théâtre. Comment êtes-vous arrivée dans ce domaine ?
Je voudrais tout d'abord souligner que c'est la série « Ina » de la réalisatrice Valérie Kaboré qui m'a révélé au public. Cela dit, j'ai effectivement débuté par le théâtre en me formant à l'Ecole de théâtre burkinabè. Nous étions d'ailleurs la toute première promotion. C'était entre les années 96-97. Cela m'a permis d'évoluer de compagnies en compagnies pour davantage m'améliorer grâces aux différents spectacles. Parmi les compagnies, il y a eu « Marbayassa » avec laquelle j'ai fait une tournée à Bordeaux. S'y ajoute « Les Merveilles du Burkina ».
Et à cette époque, il y avait « Le Grand prix de l'humour » sous l'ancien ministre de la Communication et de la Culture, Mahamoudou Ouédraogo. J'y ai participé avec Moussa Petit sergent. Nous avons, tous deux, été lauréats. Après cela, j'ai poursuivi mon chemin cette fois-ci au SITHO et ce durant une quinzaine d'années. Par la suite, je me suis lancée en freelance jusqu'à nos jours.
De la scène à l'écran, comment s'est faite la transition ?
Tout naturellement. En réalité, le théâtre, le cinéma, l'humour vont ensemble ; ce sont les enfants d'une même mère. Mais de façon concrète, pendant que j'étais à Marbayassa, j'ai appris qu'il y avait un casting du regretté Missa Hébié à la RTB. J'y ai postulé et obtenu ainsi mon premier rôle en tant qu'actrice dans la série « Sita ». Là, j'incarnais la meilleure amie de l'actrice principale. Cette série, tournée pendant trois mois à Saaba, m'a ouverte d'autres portes, notamment dans une autre intitulée « Ina » que j'ai évoquée plus haut. Dans cette production, Valérie Kaboré m'a copté pour jouer soit un rôle principal, soit l'amie de l'actrice principale.
Aujourd'hui vous portez la casquette de réalisatrice. Est-ce que vous avez suivi une formation particulière en la matière ?
Dans la vie, il y a deux sortes de formations : la théorie et la pratique. Je n'ai pas eu la chance de me former dans une école pour embrasser la carrière de réalisatrice.
Mais, j'ai eu tout de même cette formation théorique grâce aux plus de 30 plateaux de tournages sur lesquels j'ai tour à tour été costumière, assistance-costumière ou assistance-maquilleuse. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec tous les réalisateurs du Burkina et certains venus d'ailleurs pour des projets au Faso. Et lorsque j'étais sur les plateaux de tournage, après mon travail, j'observe les faits et gestes des réalisateurs de bout en bout.
C'est ainsi que je me suis formée sur le tas. N'y voyez pas une limite car beaucoup ont la théorie mais n'ont pas pu matérialiser leurs connaissances. Autrement dit, il y a des personnes diplômées dans ce domaine qui n'ont rien produit car, si la théorie n'est pas facile la pratique est davantage plus compliquée. Ma formation sur le tas m'a permise de réaliser mon premier film entre 2016-2017 baptisé « Carton rouge » qui a même été accepté au FESPACO en Panorama.
Cela prouve que ce film valait quelque chose. C'est ce qui m'a motivé à poursuivre et à enchainer avec « Madame l'ambassadrice » qui, à son tour, a fait le tour du monde. C'est cette production, disons-le, le premier film burkinabè, qui a fait le plein au théâtre Saint-André des arts à Paris.
Ce film a non seulement remporté une dizaine de prix nationaux et internationaux mais m'a aussi permis d'aller en Allemagne, en Italie et dans plusieurs autres pays. Je suis encore là, à cette 29e édition du FESPACO où mon 3e long métrage « Waongo » figure dans la sélection officielle section -Burkina.
Est-ce qu'on gagne sa vie en tant que réalisatrice ?
Ce seul métier ne saurait nourrir son homme en tout cas, pas en ce qui me concerne. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je gagne ma vie en touchant à tout. Si je ne suis pas sur scène en tant que comédienne de théâtre, je peux être sur un plateau de tournage comme actrice, ou réalisatrice ou même en faisant la promotion de l'humour.
Pour le présent rendez-vous du 7e Art, vous compétissez avec le film « Waongo » dans la section Burkina. De quoi traite ce long métrage ?
« Waongo » parle de résilience. Le film aborde l'histoire d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui s'est retrouvée dans la capitale sur un lit d'hôpital après une attaque terroriste dans sa localité. Orpheline de père, et d'une génitrice tisseuse, la jeune fille évoluait dans la couture mais nourrissait l'ambition de devenir une styliste de renom. Et comme le dit bien un adage, à quelque chose malheur est bon. A Ouaga, elle a tapé à des portes, certaines lui ont été ouvertes, d'autres sont restées closes. Mais c'est ainsi qu'elle a fini par réaliser son rêve.
Si ce n'est pas un secret combien a coûté ce film ?
Une cinquantaine de millions.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontée pour la réalisation de ce film ?
Il y en a eu à la pelle. Elles sont d'ordre financier. On n'a pas toujours les budgets nécessaires pour un projet cinématographique. Et le mien n'y pas fait l'exception. En fait, pour le cas d'espèce, j'ai bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne et du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), soit 34 millions, alors que le besoin dépassait largement ce montant. Il fallait revoir les choses à la baisse ; ce qui n'est pas évident. Malgré cela, il a fallu compter avec l'appui d'autres structures nationales sans compter que j'ai aussi puisé dans mes ressources propres pour finaliser le film.
Quel bilan tirez-vous de votre participation aux différentes éditions du FESPACO en tant que réalisatrice ?
C'est une chance d'être sélectionnée au FESPACO quand on sait que c'est un grand rendez-vous du 7e Art en Afrique et au-delà ; c'est une grande opportunité de faire partie de ceux qui verront leur production présentée à ces milliers de cinéphiles. En plus, cette vitrine offre des perspectives à « Waongo » d'être sélectionné ailleurs, étant donné que seront présents pour l'occasion des directeurs de festivals, des programmateurs et des producteurs, entre autres.
Certains estiment que le cinéma burkinabè a perdu en qualité. Etes-vous de cet avis ? Si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ?
Non, les films burkinabè n'ont pas perdu en qualité. Je dirai plutôt que les films qui viennent d'ailleurs sont plus forts, ont plus de facture car les moyens ont suivi. Les productions qui ont remporté l'Etalon d'or de Yennenga, par exemple ceux du réalisateur sénégalais Alain Gomis, en sont la parfaite illustration. Pour « Félicité », qui lui a valu son premier Etalon d'or, il parlait d'un budget de trois milliards injecté dans la réalisation.
Ce film, tout le monde l'a regardé mais en son temps tout le monde a dormi dans la salle de projection. Pourtant, ça a coûté trois milliards de FCFA et remporté le trophée le plus convoité au FESPACO. Le plus souvent, le pronostic du public n'est pas le choix du jury. Je ne saurais l'expliquer puisque ne maîtrisant pas les critères du jury.
Donc, ce n'est pas parce que nos films burkinabè ont perdu en qualité mais parce que la réalité est tout autre. Même « Sira » d'Apolline Traoré qui a été tourné en Mauritanie avec un financement extérieur, n'a même pas eu le milliard comme budget. Entre un milliard et trois, il y a une différence et la qualité n'est pas pareille au finish.
Cela pour dire qu'il faut que les gens acceptent d'investir dans ce métier, c'est un préalable. Par ailleurs, il faut que les réalisateurs en général, nos devanciers, acceptent de travailler entre eux. Je ne doute pas qu'on puisse obtenir encore l'Etalon d'or ensemble ou en solo. Il suffit qu'il y ait un peu plus de moyens, plus de créativité et le tour sera joué.
Est-ce que l'absence de nos monstres sacrés comme Idrissa Ouédraogo ou Gaston Kaboré n'expliquerait pas ce sentiment de dépréciation ?
Je ne vois pas les choses ainsi. Aux USA, les grands réalisateurs ne sont pas forcément des gens qui ont fait de grandes écoles. Même Khadar Ahmed, le Somalien qui a remporté l'Etalon d'or de Yennenga en 2021, si je ne m'abuse, n'a pas fait de grande école de cinéma. C'est juste pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Prenons « Tilaï » ou « Yaaba » d'Idrissa Ouédraogo ; notre réalisateur avait l'argent comme il voulait pour faire de la création.
Pour faire une oeuvre artistique, on ne doit pas être stressé. Pourtant, la réalité est que quand on est réalisateur, il faut courir partout pour chercher les fonds pour réaliser son film. Une fois de plus, ce n'est pas un problème de créativité mais de ressources financières. Sinon, Gaston Kaboré est toujours vivant, mais il ne fait plus de films car les choses ont changé.
Demandez-lui de faire un film aujourd'hui, il vous dira qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Imaginez-vous, après avoir décroché l'Etalon d'or, s'il s'amuse à faire un film sans y mettre le prix, ce sera un échec. C'est pourquoi il préfère former les jeunes au métier du cinéma que de réaliser des films actuellement. Ce n'est pas facile d'en faire aujourd'hui. Ceux qui le font prennent d'énormes risques dans la mesure où certains réalisateurs en viennent à hypothéquer leurs maisons en banque avec tout ce que cela peut avoir comme conséquences.
Vous avez joué dans de nombreux grands films et séries. Lequel des films et rôles vous le plus marqué et pourquoi ?
Les films qui m'ont le plus marquée sont ceux que le public a le plus aimés. On a le retour des amoureux du cinéma et à force d'entendre parler d'un de tes films, cela t'amène à aimer l'oeuvre. Car à bien l'observer, tu te rends compte que tu y as fait des performances.
Ce fut le cas, par exemple, de la première saison de la série « Ina ». On a raflé tous les prix spéciaux du FESPACO en son temps, soit plus de six récompenses. Cela est dû au fait qu'un travail de qualité a été abattu dans cette série. Je m'en souviens comme si c'était hier, tous les acteurs ont pleuré sur le plateau. Smarty, Eliane, Ina, moi, autant que nous sommes.
On avait Issa Traoré de Brahim comme réalisateur. Qui connaît l'homme sait de quoi je parle. C'est un fou. Issa, quand il te prend en jeu d'acteur et que tu rends en retour sur l'écran, c'est génial. Il a quelque chose en lui que les autres n'ont pas certainement ; il sait diriger l'acteur. Il peut t'insulter sur un plateau au point de te faire couler des larmes. Et il te demande par la suite : « Tu as fini de pleurer, maintenant va te laver les yeux, on poursuit ».
On a évolué également ainsi dans « Une femme pas comme les autres », le long métrage d'Abdoulaye Dao. On a fait la résidence à Boromo avec feu Amadou Bouro, qui nous a tenus en jeu d'acteur. On a travaillé pendant trente jours d'affilée comme si on partait à l'école et tout était réglé au détail près. Le matin, on prend le petit déjeuner à 8h et direction la scène.
A 13h, on fait la pause pour reprendre à 15h. Ce n'est qu'à 18h qu'on avait accès à nos téléphones. Il y avait de la rigueur, du sérieux, de la qualité et de la volonté de part et d'autre de faire un bon travail. Résultat, aujourd'hui, ce film, un classique, est traduit en anglais et est enseigné dans les universités américaines. En somme, ce sont ces deux films (la série TV et le long métrage) qui m'ont le plus particulièrement marqués. « Ouaga love » a été aussi apprécié par les populations.
Depuis 2022, vous êtes non seulement mariée, surtout à un chef. Comment la fille Lobi s'est-elle intégrée dans le milieu moaaga ?
(Eclats de rires !) Je m'intègre bien parce que j'ai eu la chance que mon mari, un jeune chef coutumier, soit quelqu'un qui est très ouvert en esprit. Il est Moaaga de Pouytenga, c'est un El hadj qui a accompli le 5e pilier de l'islam à quatre reprises. Il m'a connue en tant actrice et m'accepte comme telle. Il me soutient énormément.
Quand je sors le matin, je peux rentrer la nuit et il me dit de ne pas me fatiguer à faire la cuisine. C'est un jeune qui a beaucoup voyagé, il a l'esprit ouvert. Sa priorité, c'est sa famille. Il est très timide mais lorsque j'ai un spectacle ou des films, il se déplace souvent pour y assister. S'il ne vient pas, c'est qu'il a opté de rester pour s'occuper de notre enfant et cela ne lui pose aucun problème.
Comment conciliez-vous statut d'épouse, de mère, d'artiste et de surcroît reine ?
Reine, c'est trop dire. Tout est une question d'organisation. Comme comédienne, je sais faire la part des choses. Je sais que je suis l'épouse et comme telle je dois garder la maison propre, préparer pour que le mari et tous ceux qui sont à la maison mangent matin et soir. J'ai des aide-ménagères à qui je donne des directives. Sinon dès que je franchis la porte du domicile, je reprends les choses en main et ça se fait naturellement.