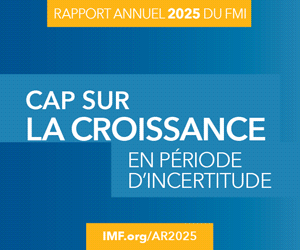De Maurice aux grandes institutions internationales, Manisha Dookhony a forgé sa vision au contact direct des réalités humaines, juridiques et financières du développement. Du terrain africain aux tables de négociation, puis au regard exigeant de l'investisseur, elle défend une économie ancrée dans la vie réelle, la solidité des institutions et la confiance. Dans cet entretien, elle livre une lecture éclairée des défis économiques et institutionnels du pays.
Votre parcours vous a menée de Maurice à des institutions internationales. Quels moments clés ont le plus façonné votre regard d'économiste aujourd'hui ?
Si je devais identifier le moment révélateur de ma pensée économique, il ne s'est pas produit dans un amphithéâtre, mais sur un chemin de terre au Rwanda. Lors d'une visite chez un habitant modeste vivant à la campagne à Ruhengeri, il a expliqué que sa vache est un actif qui l'a permis à faire un prêt et est devenue garantie pour que ses enfants aillent à l'école. Cette vache, c'était le Produit intérieur brut en action.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Cette expérience, répétée du Bénin à Madagascar, m'a enseigné que les grands équilibres macroéconomiques n'ont de sens que s'ils protègent et libèrent cette résilience humaine. À l'inverse, j'ai vu de bonnes intentions étouffées par des politiques mal calibrées. La leçon fut claire : une économie qui ignore le rythme des vies qu'elle imprègne est une économie froide et théorique.
Plus tard, à la tête du conseil de gestion l'African Legal Support Facility, mon champ de vision s'est élargi du terrain humain au terrain juridique. En finançant l'étude de faisabilité du projet d'eau Njoro Kubwa au Kénya, nous avons posé la première pierre d'un partenariat public-privé qui transformera l'accès à l'eau pour des communautés entières. Mais j'ai aussi vu l'envers du décor : des pays riches en ressources signant, par méconnaissance, des contrats qui scellaient leur appauvrissement.
J'ai alors compris que la souveraineté́ économique se gagne dans le détail des clauses. Un contrat solide est la première digue contre l'exploitation. Mon combat est devenu juridique et éthique : sans un état de droit robuste, le développement se construit sur du sable.
Aujourd'hui, en tant que CEO de Terramont Capital Partners, j'opère «de l'autre côté́ de la table». Je suis celle qui évalue ou non le risque d'investir. Cette perspective est révélatrice : ce qui fait dire «oui» à un investisseur, ce n'est rarement l'avantage fiscal le plus gros. C'est la clarté prévisible des règles, la fiabilité des institutions et la qualité́ du dialogue avec l'État. Je scrute désormais les politiques publiques à l'aune de leur crédibilité à long terme, décryptant les signaux concrets que perçoit le capital.
Ce parcours est un dialogue permanent entre plusieurs mondes : le terrain, l'institution, la table des négociations et le bureau de l'investisseur. Chaque poste d'observation m'a enseigné qu'une économie réussie est un écosystème fragile, où la vision stratégique, le cadre juridique, la capacité administrative et la confiance des investisseurs doivent s'aligner. Mon rôle aujourd'hui est précisément de faire dialoguer ces quatre éléments pour construire une prospérité́ qui soit à la fois solide, juste et tangible.
Que vous a apporté votre expérience à Harvard dans votre lecture des enjeux économiques et de gouvernance ?
Mon expérience à Harvard a été bien plus qu'un enrichissement académique; ce fut une transformation de posture. Le programme de Master of Public Administration m'a appris une leçon fondamentale : une politique économique n'est pas un théorème abstrait, c'est avant tout une histoire de personnes, de pouvoir et de processus.
J'ai appris à poser systématiquement des questions qui ne figuraient pas dans mes manuels d'économie : Qui va gagner, qui va perdre avec cette réforme, et comment les perdants potentiels peuvent-ils bloquer le processus ? Quel ministre, quel directeur général d'administration a intérêt à porter ce projet, et en a-t-il les moyens politiques ? Et comment expliquer cette complexité technique à un citoyen, à un petit entrepreneur, pour qu'il en perçoive le bénéfice et non seulement la contrainte ?
À Harvard, les études de cas nous plongeaient dans la peau d'un maire, d'un ministre des Finances ou d'un responsable d'agence en crise. Je me souviens d'un exercice sur une réforme fiscale où, malgré notre modèle économétrique impeccable, nous avions échoué parce que nous avions négligé de construire une coalition avec les syndicats et la presse. L'échec était plus instructif que n'importe quel succès théorique.
Lorsqu'on conçoit une politique de transition énergétique ou une réforme du marché du travail, il faut immédiatement penser à son architecture de gouvernance. Qui va piloter ? Comment on consulte les entreprises et la société civile en amont, pas pour la forme, mais pour intégrer leurs contraintes ? Comment on forme les fonctionnaires qui devront appliquer des règles nouvelles ? Sans ces briques, la plus belle des lois reste lettre morte.
Mon passage à Harvard a ouvert un réseau mondial et vivant, particulièrement actif en Afrique et au Moyen-Orient. La semaine prochaine, j'interviendrai au Harvard Alumni Summit 2026 au Grand Egyptian Museum, où je rejoindrai d'autres diplômés, leaders et innovateurs pour réfléchir à l'avenir de la santé, de l'éducation et de l'économie numérique.
Comment votre double formation se reflète-t-elle dans votre analyse des politiques économiques ?
Elle m'amène à toujours poser deux questions : Cette politique est-elle économiquement solide ? Peut-on réellement la gérer et la faire accepter ? Par exemple, une fiscalité optimale sur papier peut créer des lourdeurs administratives ou des effets pervers si elle ne tient pas compte des spécificités du tissu productif local. L'administration publique est le canal par lequel l'économie touche les citoyens ; négliger ce canal, c'est condamner les idées à rester sur le papier.
Ma double formation agit comme une paire de lentilles complémentaires à travers lesquelles j'évalue toute politique. L'économie me donne la théorie, les modèles et les indicateurs quantitatifs. L'administration publique m'apporte la réalité des institutions, des processus et des comportements humains au sein de la machine étatique et de la société.
À l'aube de 2026, dans quel état jugez-vous l'économie ?
L'économie mauricienne se trouve dans un état de convalescence inégale. Les signes vitaux sont positifs : la reprise touristique est solide, les secteurs de la finance et du numérique résistent bien, et notre résilience institutionnelle demeure un atout. Mais le patient est encore fragile. Nous naviguons avec des déficits double - budgétaire et commercial - qui exigent une discipline renouvelée, une inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages, et une croissance qui ne profite pas encore à tous de manière palpable.
Cette situation économique ne peut se comprendre sans lire sa dimension politique. Pour 2026, le véritable défi ne sera pas seulement de concevoir de nouvelles politiques mais surtout de les mettre en oeuvre dans un contexte social et politique complexe.
Comment concilier rigueur économique, inclusion sociale et transformation durable à Maurice à l'horizon 2026 ?
En ce qui concerne la tension entre la rigueur budgétaire et la protection sociale, rationaliser les dépenses publiques et réduire les déficits sont des impératifs économiques. La réussite en 2026 dépendra de la capacité à construire un consensus autour d'un effort national équitable, en protégeant précisément les plus vulnérables et en expliquant la nécessité des réformes.
Au sujet de la tension entre le court terme politique et le long terme économique, la tentation des projets à visibilité immédiate est forte. Pourtant, notre avenir commun dépend d'investissements dont les bénéfices s'inscrivent dans la durée. La transition énergétique face à la vulnérabilité climatique, la refonte profonde de notre système éducatif et de formation, ou le virage vers une économie bleue et circulaire. 2026 doit marquer le début d'un véritable pacte intergénérationnel, porté par des institutions stables capables de mener ces projets au-delà des cycles électoraux. Et on a vu un début avec la présentation de la vision 2050.
Notre modèle de prospérité est bâti sur l'ouverture aux investissements, au tourisme et aux marchés internationaux. Dans le même temps, il faut répondre à une demande légitime de mieux ancrer les bénéfices de la croissance dans l'économie locale, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de préserver notre cohésion sociale. L'État devra jouer le rôle de médiateur stratège : attirer les investissements de niche (Finance, Fintech, biopharmacie, services spécialisés) tout en s'assurant qu'ils créent des emplois de qualité, transfert des compétences et dynamisent les chaînes de valeur locale.
Le coût de la vie et du travail augmente, mais notre productivité, elle, stagne. La solution n'est pas de freiner les salaires, mais d'investir massivement et intelligemment incluant dans les solutions IA (intelligence artificielle). Cela passe par une révolution de la formation, alignée sur les métiers d'avenir comme les énergies renouvelables ou la biopharmacie. Cela exige aussi une gestion audacieuse et pragmatique de la main-d'œuvre étrangère : attirer de manière sélective les talents et compétences critiques dont nous avons urgemment besoin ainsi que leur formation exemple dans l'hôtellerie à la manière de faire Mauricienne.
Nos côtes, nos infrastructures, notre sécurité alimentaire sont en première ligne. Chaque cyclone nous rappelle, que notre vulnérabilité est systémique. Dans ce contexte, investir dans la résilience - que ce soit par des digues intelligentes, des systèmes hydriques durables ou une agriculture climato-intelligente - est indispensable.
La question de la propreté à travers l'île est une urgence civique et écologique. Un environnement dégradé aggrave les risques sanitaires, nuit à notre attractivité et compromet les écosystèmes qui nous protègent. La réponse ne peut se limiter à des campagnes de nettoyage, aussi nécessaires soient-elles. Elle doit être systémique : par la mise en place d'infrastructures modernes de tri et de traitement des déchets, par une économie circulaire qui valorise nos ressources, et par une sensibilisation continue qui fait de chaque citoyen et chaque entreprise un acteur de la préservation.
L'inclusion quant à elle passe par des politiques de mobilité sociale concrètes, par la décentralisation des opportunités et par un accès équitable à un logement décent. La cohésion sociale est notre atout le plus précieux; nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser se fissurer.
Enfin, nous devons affronter la menace souterraine qui ronge notre capital humain et notre sécurité : le fléau de la drogue. Y faire face demande une stratégie implacable, mêlant répression, prévention dans les quartiers et les écoles, et programmes de réinsertion.
L'incertitude internationale change-t-elle la manière dont un petit État insulaire doit penser son développement ?
Notre boussole stratégique doit radicalement changer d'orientation. Il ne s'agit plus simplement d'optimiser pour la croissance à court terme, mais de construire une résilience systémique. Cela signifie de transformer nos vulnérabilités apparentes - notre taille, notre éloignement - en atouts décisifs : l'agilité, la cohésion sociale et une capacité unique à nous réinventer.
Cette réflexion inclut une dimension géostratégique majeure, celle du retour des Chagos dans notre giron national. Cette perspective, bien que marquée par des délais diplomatiques complexes, n'est pas qu'une question de souveraineté ; c'est un impératif de planification économique à long terme. Nous devons dès aujourd'hui développer l'expertise scientifique, logistique et de gouvernance environnementale pour gérer cet immense territoire marin de manière durable et innovante.
Cette résilience et cette vision stratégique exigent une diversification intelligente. Premièrement, faire de l'océan notre laboratoire d'avenir. Imaginez Maurice comme un hub de Blue Biotech, où l'on extrait des molécules marines pour la médecine de demain, ou comme un centre d'aquaculture high-tech.
Notre position géographique fait aussi de nous le lieu naturel pour des services maritimes spécialisés - de l'assurance écologique à l'arbitrage maritime - protégeant et régulant les artères commerciales du globe.
Il faut la capitaliser sur notre réputation de fiabilité et de sérieux géopolitique pour attirer non seulement des capitaux, mais le savoir-faire qui gère et structure ces capitaux. Maurice peut devenir le cœur de la structuration du patrimoine panafricain.
De même, nous avons tous les atouts pour développer un pôle biopharmaceutique et de santé numérique. Chaque nouveau service - qu'il soit juridique, fiscal ou technologique - doit viser cette excellence de niche.
Le climat des affaires et la confiance des investisseurs sont-ils suffisamment solides ?
Ils sont solides relativement à la région, mais insuffisants pour l'ambition de devenir une économie à haut revenu. Les lourdeurs administratives, les lenteurs judiciaires pour les litiges commerciaux et les défis en matière de transparence persistent. Il faut passer d'un climat «bon pour l'Afrique» à un climat «compétitif au niveau mondial». Cela demande une mise en question, une réforme régulière, ciblée et évaluée, pas seulement des incitations fiscales ciblées pour certains secteurs.
Comment mieux aligner formation, emploi et besoins du marché ?
Aligner formation et emploi est bien plus qu'un défi technique; c'est le chantier social et économique le plus urgent pour notre avenir. Aujourd'hui, un fossé se creuse entre les salles de classe et le monde du travail, et ce fossé grève notre compétitivité et brise des carrières.
Au lieu d'observatoires théoriques, imaginons pour chaque filière d'avenir - la FinTech, l'économie bleue, la santé - un Conseil Sectoriel des Compétences dirigé par l'industrie. Son rôle ? Détecter, chaque année, les métiers en tension et les compétences émergentes. Ces données doivent devenir le GPS qui oriente les financements publics, les cursus universitaires, et même notre politique d'immigration professionnelle. Il s'agit de passer du «besoin en numérique» au «besoin urgent de 50 analystes en cybersécurité pour les banques».
L'immersion en entreprise doit cesser d'être une formalité pour devenir un véritable «saut dans le vrai». Nous devons aussi inclure nos très petites entreprises (TPE) et PME, souvent riches d'un savoir-faire unique mais dépourvues de moyens pour encadrer des stagiaires. Un portail de mise en relation et un fonds de compensation pourraient libérer ce potentiel.
Créons un véritable «crédit-formation» personnel, abondé par l'individu, l'employeur et l'État, utilisable pour des certifications reconnues par les professionnels. Conditionnons aussi les incitations fiscales aux entreprises à l'efficacité réelle des formations continues, mesurée par la validation de nouvelles compétences. Et enfin, érigeons des «Campus des Métiers d'Excellence» en partenariat avec l'industrie, pour faire du diplôme technique un passeport de prestige vers l'emploi.
Développons des micro-certifications reconnues par l'industrie, accessibles en ligne ou en soirée, qui permettent à un travailleur de se spécialiser ou de se réorienter tout au long de sa vie. Une Plateforme Nationale des Compétences deviendrait alors le compagnon de route de chaque Mauricien, lui permettant d'évaluer ses compétences, de visualiser les métiers porteurs et d'accéder au bon module de formation au bon moment.
En une phrase, comment résumeriez-vous votre «Vision 2026» pour Maurice ?
Une résilience proactive : transformer les vulnérabilités géographiques en avantages d'agilité, et la diversité sociale en moteur d'innovation inclusive.